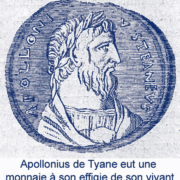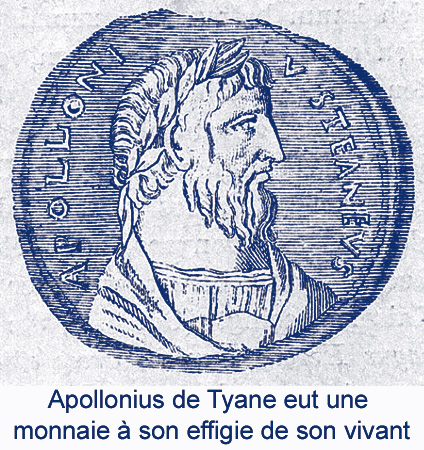 Apollonius de Tyane, né aux environs de l’an zéro, dit le Christ grec pythagoricien, a été occulté presque effacé par le Judéo-Christianisme. Il existe pourtant des ouvrages historiques relatant la vie d’Apollonius, contrairement aux évangiles qui ne citent aucune source concernant Jésus. Le fait qu’il y ait eu deux Christ aux environs de l’an zéro est en soi révolutionnaire. La doctrine chrétienne s’est très largement inspirée des rituels et traditions, dits païens, qui la précédèrent. La comparaison entre Apollonius de Tyane et Jésus nous permet de dévoiler certaines sources à partir desquelles fut fabriqué le Judéo-Christianisme…
Apollonius de Tyane, né aux environs de l’an zéro, dit le Christ grec pythagoricien, a été occulté presque effacé par le Judéo-Christianisme. Il existe pourtant des ouvrages historiques relatant la vie d’Apollonius, contrairement aux évangiles qui ne citent aucune source concernant Jésus. Le fait qu’il y ait eu deux Christ aux environs de l’an zéro est en soi révolutionnaire. La doctrine chrétienne s’est très largement inspirée des rituels et traditions, dits païens, qui la précédèrent. La comparaison entre Apollonius de Tyane et Jésus nous permet de dévoiler certaines sources à partir desquelles fut fabriqué le Judéo-Christianisme…
Sources historiques
Le rhéteur Philostrate (170-240) dans son livre, « La Vie d’Apollonius de Tyane » s’appuie sur les œuvres du maître lui-même, un fragment de sa vie par Maxime d’Aegae, les quatre livres de Moeragérès et l’histoire d’Apollonius écrite par son disciple Damis de Ninive. Pour Jésus, aucun évangéliste ne fait état de sources.
Très minutieux, Philostrate ne se borna pas à faire des recherches en bibliothèque publique. Il enquêta dans les villes où Apollonius avait séjourné et dans les temples dont il restaura les rites. De plus, il consulta les lettres du maître, soit leurs originaux, soit leurs copies. Apollonius de Tyane était connu dans l’Empire Romain, jusqu’aux Indes et en Egypte. Il communiqua avec des rois, des Sophistes (pratiquant de la déesse Sophia), des personnalités d’Elide, de Delphes, d’Inde, d’Égypte. Ses enseignements adressés aux puissants de son époque et à certains ordres sacerdotaux concernaient les mœurs des hommes, la morale, les lois, les dieux et les rites dont il redressait les erreurs. Apollonius était d’origine aristocratique. Il est né vers l’an zéro, à Tyane, au cœur de la Cappadoce (à Kemerhisar de la Turquie actuelle).
Annonciation
L’annonciation décrit, dans la Chrétienté, l’intervention de l’archange Gabriel annonçant à la vierge Marie qu’elle sera mère du Christ. Cet épisode est également applicable à la naissance du Christ grec. Philostrate relate l’annonce faite à la mère d’Apollonius en ces termes :
« Alors que sa mère le portait encore dans son sein, elle vit apparaître une divinité égyptienne… Sans être le moins du monde effrayée, elle lui demanda de quoi elle accoucherait, et il répondit : « De moi ! – Et toi, qui es-tu ? lui demanda t-elle. – Protée, le dieu égyptien, répondit-il ».
Jean Louis Bernard commente ainsi les deux annonciations :
« Entre l’ange Gabriel, messager céleste avertissant Marie de la proche naissance de Jésus, et ce dieu égyptien qui va renaître lui-même dans l’enfant, il y a toute la différence entre le monothéisme populaire des Juifs et le polythéisme savant et nuancé des élites païennes. La nativité du Christ Apollonius se greffe sur la tradition égyptienne, sur la théogamie… La théogamie (théos = dieu, gamos = noces) correspondait, en Egypte et en Grèce, à l’incarnation d’un dieu, d’une déesse, en somme d’un être céleste, au cours de l’acte sexuel d’un couple ». Cette tradition protohistorique d’incarnations divines a toujours été le socle des sciences spirituelles de l’Antiquité, pratiquées en Gaule, en Grèce, en Egypte et en Asie. Les rédacteurs évangéliques du dieu unique l’appliquèrent de manière exclusive à Jésus, en faisant table rase du principe de réincarnation et de toute forme de sexualité sacrée.
Apollonius incarnation du dieu Protée
Le dieu Protée se greffe sur la tradition de l’Atlantide dont l’Egypte était l’héritière lointaine. Protée était le fils de Poséidon, dieu de l’archipel disparu et de l’étoile polaire source de l’influx cosmique, sous-tendant toute vie sur Terre. Protée était un berger. Dormant dans une grotte, il paissait les troupeaux géants des Atlantes, géants eux-mêmes… Il prédisait l’avenir et savait changer d’apparence à volonté, soit en métamorphosant sa forme corporelle, soit en abusant autrui par la suggestion. Du point de vue de la tradition, cet ancêtre divinisé s’est incarné en Apollonius pour continuer sa mission. Appelé « fils de Zeus », « fils d’Apollon » ou « incarnation de Protée » de son vivant, Apollonius se dira simplement « fils de lui-même ».
L’adaptation judéo-chrétienne de la théogamie supprima toute référence au culte des ancêtres réalisés et divinisés, revenant périodiquement s’incarner sur Terre. Elle fit de Jésus l’émanation directe et unique d’un Dieu absolu sans nom et sans filiation. Pour renforcer cette thèse, les Judéo-Chrétiens affirmèrent que Marie l’avait enfanté vierge, et qu’elle demeura toujours vierge ! Pourtant, Jésus est son premier né (Luc, II, 6-7) et il aura des frères (Jean, II, 12)… D’autre part, Jésus, écrit « Iésus » en l’an zéro est, selon la tradition, l’incarnation du dieu gaulois Esus. Cet aspect de la tradition a été également effacé.
Naissance de deux enfants divins
A l’époque romaine, un temple commémorait la naissance du Christ Apollonius, construit dans la prairie où sa mère avait accouché. Des pèlerins y viendront en foule, pendant que d’autres iront à Bethléem, lieu de naissance présumé de Jésus.
« Comme sa mère était sur le point d’accoucher, elle eut un rêve qui lui ordonna d’aller dans la prairie, afin d’y cueillir des fleurs. Lorsqu’elle y fut allée, les servantes s’occupèrent de cueillir les fleurs, en se dispersant à travers la prairie, et elle-même s’abandonna au sommeil, étendue sur l’herbe. Or, des cygnes qui pâturaient dans la prairie, formèrent un chœur autour d’elle, alors qu’elle dormait. Soulevant leurs ailes, ainsi qu’ils ont coutume de le faire, ils se mirent à crier tous ensemble, tandis qu’une petite brise soufflait sur la prairie. Elle s’éveilla brusquement, à leurs cris, et fut délivrée car toute émotion soudaine est susceptible de provoquer un accouchement, même avant terme. Et les gens du pays assurent qu’au moment où elle accouchait, un trait de foudre sembla sur le point de frapper la terre, mais que, remontant vers l’éther, il disparut dans le ciel – les dieux indiquant ainsi, la célébrité qui devait mettre l’enfant au-dessus de tout ce qui est au monde, l’installant près des dieux, bref, tout ce qu’il fut plus tard » (1, 5 Philostrate).
 Le « trait de foudre », est le pendant de l’étoile des bergers, immobilisée sur la crèche, à Bethléem. Il s’agit symboliquement de l’étoile polaire, siège éternel des déesses et des dieux. C’est aussi le symbole du culte féminin protohistorique visant à engendrer des enfants divins purifiés par le flux céleste polaire. En outre, la mère d’Apollonius de Tyane était une pratiquante de la déesse Diane et la vierge Marie, vraisemblablement une prêtresse des temples d’Artémis et d’Isis. Toutes deux issues d’ordres sacerdotaux féminins ont pratiqué une sexualité sacrale de purification subtile et une discipline préparatoire à l’accouchement. Cet aspect des choses a été soigneusement occulté dans le Judéo-Christianisme qui détruisit toute science médicale et spirituelle féminine. Avec la montée du patriarcat naissant, toute femme devait « accoucher dans la douleur ».
Le « trait de foudre », est le pendant de l’étoile des bergers, immobilisée sur la crèche, à Bethléem. Il s’agit symboliquement de l’étoile polaire, siège éternel des déesses et des dieux. C’est aussi le symbole du culte féminin protohistorique visant à engendrer des enfants divins purifiés par le flux céleste polaire. En outre, la mère d’Apollonius de Tyane était une pratiquante de la déesse Diane et la vierge Marie, vraisemblablement une prêtresse des temples d’Artémis et d’Isis. Toutes deux issues d’ordres sacerdotaux féminins ont pratiqué une sexualité sacrale de purification subtile et une discipline préparatoire à l’accouchement. Cet aspect des choses a été soigneusement occulté dans le Judéo-Christianisme qui détruisit toute science médicale et spirituelle féminine. Avec la montée du patriarcat naissant, toute femme devait « accoucher dans la douleur ».
Apparitions des dieux et déesses dans l’Antiquité
Esculape dieu de médecine
Philostrate relate qu’Apollonius de Tyane devint l’hôte d’un temple d’Asclépios (Esculape), dieu de la médecine. Ce temple était renommé parce que les apparitions du dieu y étaient fréquentes. Dans le Christianisme, le dieu (le Christ) et la déesse (la Vierge) se manifestent rarement. Quand se produit un tel miracle, plusieurs constantes reviennent : la grotte (à Lourdes), le chêne (à Fatima) et la jeune fille vierge, très jeune, à peine pubère. Il semble que l’esprit mystique et l’état virginal favorisent et stimulent la voyance et autres facultés parapsychiques, permettant de percevoir les manifestations du monde subtil.
Une fée
Dans l’Antiquité, l’Egypte et l’Asie mineure connurent fréquemment ces phénomènes d’apparition dans des grottes ou des temples. Un papyrus égyptien relate l’émoi d’un berger, auquel se manifesta une fée dans une grotte.
La déesse Hathor
Au temple de la déesse Hathor, à Tentyris (Dendérah), le temple le mieux conservé de l’Egypte, existe une petite salle, dite de l’apparition. Les poèmes égyptiens décrivent sans ambiguïté la matérialisation de la déesse Hathor devant le pharaon. Elle surgit, diaphane, dans l’encadrement d’une porte, en forme complète. Elle est qualifiée de « radieuse » parce qu’elle a une aura lumineuse, et d’elle émane un parfum suave. Pour qu’elle se manifeste, il fallait la présence du pharaon, époux mystique de la déesse, sans laquelle il ne serait pas souverain de droit divin. Le pharaon dansait et chantait en agitant des sistres pour invoquer Hathor. L’apparition de la déesse produisait sur lui un effet sensoriel, une joie érotique, que les initiés grecs aux mystères nommèrent « ivresse dionysiaque ».
Le dieu Amon et la reine Hatshepsout
Un texte, gravé sur le temple funéraire de la reine Hatshepsout, relate sa rencontre avec le dieu Amon :
« Alors, vint ce dieu magnifique Amon, maître du trône du double pays. Après avoir pris l’apparence de son époux, il la trouva endormie dans la beauté de son palais. Le parfum du dieu la réveilla. Et elle sourit devant Sa Majesté (le dieu Amon, qu’elle pris pour son époux).
Tout de suite, il s’approcha d’elle, et pour elle, perdit son cœur. Elle put le voir dans sa stature divine, après qu’il eût approché d’elle. Elle était heureuse de contempler sa beauté. Son amour pénétra dans son corps. Le palais était inondé du parfum du dieu ». (Cité par Siegfried Schott dans « Les chants d’amour de l’Egypte ancienne », Maisonneuve.)
Aphrodite
Dans le célèbre roman grec Chéréas et Callirhoé, composé au début de notre ère par Chariton d’Aphrodise, celui-ci parle d’une chapelle d’Aphrodite, aux environs de Milet (en Asie mineure, sur la mer Egée) où les apparitions de la déesse se produisaient souvent.
Depuis la plus haute Antiquité, de la Gaule jusqu’au Japon, il est question d’apparitions d’ancêtres divinisés, d’émanations divines et célestes se manifestant pour enseigner l’humanité.
L’homme sans tombeau
Apollonius de Tyane sera nommé « l’homme sans tombeau » car parti en apothéose sans laisser de corps ici bas. Ce phénomène de disparition du corps en lumière est nommé assomption pour la Vierge et ascension pour le Christ. En Asie, on appelle cela illumination du corps du bouddha ou corps d’arc-en-ciel au Tibet. Dans le Druido-Odinisme, c’est le franchissement du voile de lumière. Ce phénomène d’illumination des éveillés au moment de la mort est connu depuis la nuit des temps. Les Judéo-Chrétiens occulteront toute la tradition antérieure n’accordant ce phénomène d’illumination qu’à Jésus et à Marie.
Conclusion
La vie d’Apollonius de Tyane nous permet de comprendre le contexte spirituel au moment présumé de la naissance du Christ. Le Judéo-Christianisme s’est approprié les traditions païennes tout en les déformant. Ensuite, il a fait table rase de tous les savoirs antiques, n’admettant de présence divine que pour le Christianisme et de théogamie que pour Jésus. Pour imposer un Dieu unique dans un monde polythéiste raffiné multimillénaire, il fallait détruire les bibliothèques, les temples et toutes sources dites païennes. Les temples dédiés à Apollonius de Tyane furent fermés par l’Empereur chrétien Constantin. Le culte à Apollonius de Tyane sera interdit par l’Eglise mais continuera à être secrètement pratiqué. Dans l’iconographie chrétienne tout laisse à penser que le Christ en gloire était une représentation d’Apollonius de Tyane dans l’esprit des fidèles de la tradition. L’idée d’offrir du sang ou de la chair, même psychiquement, n’a jamais fait partie de la tradition primordiale. Seul le lait magnétisé était donné aux fidèles pour les purifier et les soigner.
Frédéric Morin
Apollonius de Tyane et Jésus, Jean Louis Bernard,
pp. 89-98, éd. Robert Laffont, 1977.